aux newsletters du Journal ! Je m'inscris
Histoire générale de la Vallée de Montmorency - 3ème épisode : la consolidation de la construction féodale et la Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris"
SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900
Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.
Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.
3ème épisode : la consolidation de la construction féodale et la Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris"
Cette période est marquée par la fin de la dynastie des seigneurs de Montmorency, dont l’histoire culmine avec le connétable Anne de Montmorency né en 1493, et qui meurt à la bataille de Saint-Denis contre l’armée du prince de Condé en 1567. On lui doit notamment, en 1563, l’achèvement de la nef de la collégiale de Montmorency, qui deviendra église paroissiale en 1631. Son fils, le maréchal Henri II est le dernier duc de Montmorency, puisqu’il est décapité en 1632 à Toulouse, sans descendance directe. Son immense domaine, érigé en duché-pairie, est donné par Louis XIII, en 1633, au prince Henri de Condé, duc de Bourbon, qui a épousé en 1610, Charlotte-Marguerite, la sœur d’Henri II de Montmorency, mettant ainsi fin à une rivalité séculaire entre les deux grandes lignées. Les princes de Condé s’appliqueront, durant toute la période précédant la Révolution, à consolider leur emprise féodale sur les seigneuries villageoises de la Vallée de Montmorency, tout en ne résidant pas dans leur châtellenie, qu’ils gèrent depuis leur château d’Écouen.
La Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris". Les notables de la capitale, nobles ou bourgeois, s’installent "à la campagne", où ils se rendent durant la belle saison, tout en gardant leur domicile parisien. Ces privilégiés ont trois catégories de motivations pour posséder une propriété dans les environs de Paris :
- être à la campagne, fuir les miasmes parisiens et respirer le bon air, dont la Vallée s’est faite une réputation.
- acquérir éventuellement un titre nobiliaire en achetant un fief.
- produire des fruits, que l’on est fier de montrer à Paris quand on a des invités de marque.
Ces nouveaux résidents coexistent paisiblement, et collaborent même de façon fructueuse, avec les cultivateurs : ils font vivre un certain nombre d’habitants de la région, jardiniers, intendants, maçons, notamment. Leurs innovations en matière agricole (fruitière notamment, mais aussi vinicole) ont des répercussions heureuses sur les cultivateurs de la Vallée. Étant tous vassaux du même seigneur - qui tient son territoire de main ferme - ils n’ont aucune raison de se battre entre eux. Les paysans s’adonnent encore à la culture de la vigne, mais celle-ci perd peu à peu de son importance, en raison de la concurrence des vins de Bourgogne et de Bordeaux. Les cultivateurs se tournent de plus en plus vers la production de fruits, dont la population parisienne, qui a crû considérablement, est friande. C’est ainsi notamment que naît la réputation de la cerise de Montmorency, mais aussi des poires de Groslay.
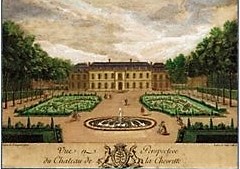 La mode des grands jardins paysagers
La mode des grands jardins paysagers
Le XVIIe siècle voit fleurir dans la Vallée les grands parcs paysagers, que l’on nomme aussi jardins anglais. De 1636 à 1645, l’incroyable Michel Puget de Montauron, qui s’est offert le luxe d’acheter la dédicace par Corneille de sa pièce Cinna, embellit le domaine de la Chevrette à Deuil, où il mène grand train. De 1670 à 1690, le peintre de cour Charles Lebrun édifie un domaine fastueux à Montmorency, où il accueille tout ce que la Cour compte de hauts personnages, dont l’illustre Bossuet. De son côté, le maréchal de Catinat, qui s’est retiré à Saint-Gratien en 1702, après une carrière exemplaire, aménage avec goût sa propriété longeant l’étang Neuf de Montmorency, qui deviendra le lac d’Enghien. Cette mode des parcs à l’anglaise, qui supplante peu à peu celle des jardins à la française illustrée par Le Nôtre, se répand dans toute la Vallée au XVIIIe siècle. Les grands propriétaires rivalisent d’ingéniosité et de faste.
 À Eaubonne, le financier Joseph-Florent Lenormand de Mézières se taille, dans les années 1760, un vaste domaine seigneurial en réunissant une grande partie des anciens fiefs féodaux de la paroisse d’Eaubonne, et fait construire par l’architecte Ledoux un petit ensemble urbain et des villas, dont le poète Saint-Lambert sera locataire. À Franconville, le Comte d’Albon fait construire dans les années 1780 un incroyable parc, dont parle tout Paris, grâce à l’ouvrage "Description d’une partie de la vallée de Montmorenci", que Le Prieur publie en 1784.
À Eaubonne, le financier Joseph-Florent Lenormand de Mézières se taille, dans les années 1760, un vaste domaine seigneurial en réunissant une grande partie des anciens fiefs féodaux de la paroisse d’Eaubonne, et fait construire par l’architecte Ledoux un petit ensemble urbain et des villas, dont le poète Saint-Lambert sera locataire. À Franconville, le Comte d’Albon fait construire dans les années 1780 un incroyable parc, dont parle tout Paris, grâce à l’ouvrage "Description d’une partie de la vallée de Montmorenci", que Le Prieur publie en 1784.
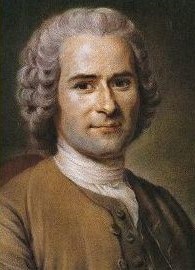 L’ère des "Lumières"
L’ère des "Lumières"
Les cinquante années précédant la Révolution voient se développer les salons littéraires et philosophiques où mûrissent les idées qui prépareront les événements de 1789. Tous les grands noms de l’intelligentsia de l’époque se réunissent l’hiver dans les hôtels de Paris, d’Auteuil ou de Passy, mais à la belle saison, dans les châteaux de la Vallée, en particulier ceux de Mme d’Epinay à La Chevrette (Deuil), de Saint-Lambert à Eaubonne, de Mme d’Houdetot à Sannois et, un peu plus tard, de Mme Broutin à Cernay (Ermont). Le bref mais fructueux séjour de Jean-Jacques Rousseau (de 1757 à 1762) dans la Vallée consacrera la renommée de cette dernière. Le "pèlerinage" à Montmorency deviendra le point de passage obligé des excursions dominicales des Parisiens, à mesure que se développeront les "transports en commun" : les premières lignes de messageries par carrosses à quatre places et guinguettes à six ou huit places sont créées dans la Vallée en 1778.
Pendant cette période, cependant, la vie des paysans valmorencéens s’alourdit. Les parcelles de terre se réduisent de génération en génération et les familles, corvéables et taillables à merci, vivent modestement et sont dépendants des événements climatiques. C’est ainsi qu’ils sont frappés de plein fouet par la terrible grêle qui, le 13 juillet 1787, ravage toute l’Ile-de-France jusqu’à Orléans. Quarante-trois paroisses manquent leurs récoltes. L'hiver de 1788-1789 est marqué par un froid terrible. Les fontaines tarissent, les puits se changent en glaçons, les moulins à eau s'arrêtent, le vin gèle dans les caves. L’Oise est prise pendant six semaines à Pontoise. Quelques paysans essayent de manger du son, d'autres de l'herbe bouillie. Le froid cesse avec le printemps, mais la famine continue. Une grande disette frappe tout le royaume et, entre autres, la Vallée, dont le Plessis-Bouchard, Sannois, Taverny, Bessancourt…
A suivre :
4ème épisode : la Révolution puis l'emprise napoléonnienne sur la Vallée !
Déjà publiés :
1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge
2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale
SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900
Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.
Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.
3ème épisode : la consolidation de la construction féodale et la Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris"
Cette période est marquée par la fin de la dynastie des seigneurs de Montmorency, dont l’histoire culmine avec le connétable Anne de Montmorency né en 1493, et qui meurt à la bataille de Saint-Denis contre l’armée du prince de Condé en 1567. On lui doit notamment, en 1563, l’achèvement de la nef de la collégiale de Montmorency, qui deviendra église paroissiale en 1631. Son fils, le maréchal Henri II est le dernier duc de Montmorency, puisqu’il est décapité en 1632 à Toulouse, sans descendance directe. Son immense domaine, érigé en duché-pairie, est donné par Louis XIII, en 1633, au prince Henri de Condé, duc de Bourbon, qui a épousé en 1610, Charlotte-Marguerite, la sœur d’Henri II de Montmorency, mettant ainsi fin à une rivalité séculaire entre les deux grandes lignées. Les princes de Condé s’appliqueront, durant toute la période précédant la Révolution, à consolider leur emprise féodale sur les seigneuries villageoises de la Vallée de Montmorency, tout en ne résidant pas dans leur châtellenie, qu’ils gèrent depuis leur château d’Écouen.
La Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris". Les notables de la capitale, nobles ou bourgeois, s’installent "à la campagne", où ils se rendent durant la belle saison, tout en gardant leur domicile parisien. Ces privilégiés ont trois catégories de motivations pour posséder une propriété dans les environs de Paris :
- être à la campagne, fuir les miasmes parisiens et respirer le bon air, dont la Vallée s’est faite une réputation.
- acquérir éventuellement un titre nobiliaire en achetant un fief.
- produire des fruits, que l’on est fier de montrer à Paris quand on a des invités de marque.
Ces nouveaux résidents coexistent paisiblement, et collaborent même de façon fructueuse, avec les cultivateurs : ils font vivre un certain nombre d’habitants de la région, jardiniers, intendants, maçons, notamment. Leurs innovations en matière agricole (fruitière notamment, mais aussi vinicole) ont des répercussions heureuses sur les cultivateurs de la Vallée. Étant tous vassaux du même seigneur - qui tient son territoire de main ferme - ils n’ont aucune raison de se battre entre eux. Les paysans s’adonnent encore à la culture de la vigne, mais celle-ci perd peu à peu de son importance, en raison de la concurrence des vins de Bourgogne et de Bordeaux. Les cultivateurs se tournent de plus en plus vers la production de fruits, dont la population parisienne, qui a crû considérablement, est friande. C’est ainsi notamment que naît la réputation de la cerise de Montmorency, mais aussi des poires de Groslay.
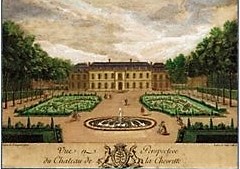 La mode des grands jardins paysagers
La mode des grands jardins paysagers
Le XVIIe siècle voit fleurir dans la Vallée les grands parcs paysagers, que l’on nomme aussi jardins anglais. De 1636 à 1645, l’incroyable Michel Puget de Montauron, qui s’est offert le luxe d’acheter la dédicace par Corneille de sa pièce Cinna, embellit le domaine de la Chevrette à Deuil, où il mène grand train. De 1670 à 1690, le peintre de cour Charles Lebrun édifie un domaine fastueux à Montmorency, où il accueille tout ce que la Cour compte de hauts personnages, dont l’illustre Bossuet. De son côté, le maréchal de Catinat, qui s’est retiré à Saint-Gratien en 1702, après une carrière exemplaire, aménage avec goût sa propriété longeant l’étang Neuf de Montmorency, qui deviendra le lac d’Enghien. Cette mode des parcs à l’anglaise, qui supplante peu à peu celle des jardins à la française illustrée par Le Nôtre, se répand dans toute la Vallée au XVIIIe siècle. Les grands propriétaires rivalisent d’ingéniosité et de faste.
 À Eaubonne, le financier Joseph-Florent Lenormand de Mézières se taille, dans les années 1760, un vaste domaine seigneurial en réunissant une grande partie des anciens fiefs féodaux de la paroisse d’Eaubonne, et fait construire par l’architecte Ledoux un petit ensemble urbain et des villas, dont le poète Saint-Lambert sera locataire. À Franconville, le Comte d’Albon fait construire dans les années 1780 un incroyable parc, dont parle tout Paris, grâce à l’ouvrage "Description d’une partie de la vallée de Montmorenci", que Le Prieur publie en 1784.
À Eaubonne, le financier Joseph-Florent Lenormand de Mézières se taille, dans les années 1760, un vaste domaine seigneurial en réunissant une grande partie des anciens fiefs féodaux de la paroisse d’Eaubonne, et fait construire par l’architecte Ledoux un petit ensemble urbain et des villas, dont le poète Saint-Lambert sera locataire. À Franconville, le Comte d’Albon fait construire dans les années 1780 un incroyable parc, dont parle tout Paris, grâce à l’ouvrage "Description d’une partie de la vallée de Montmorenci", que Le Prieur publie en 1784.
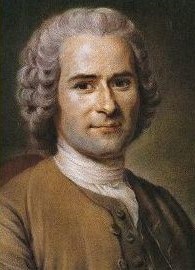 L’ère des "Lumières"
L’ère des "Lumières"
Les cinquante années précédant la Révolution voient se développer les salons littéraires et philosophiques où mûrissent les idées qui prépareront les événements de 1789. Tous les grands noms de l’intelligentsia de l’époque se réunissent l’hiver dans les hôtels de Paris, d’Auteuil ou de Passy, mais à la belle saison, dans les châteaux de la Vallée, en particulier ceux de Mme d’Epinay à La Chevrette (Deuil), de Saint-Lambert à Eaubonne, de Mme d’Houdetot à Sannois et, un peu plus tard, de Mme Broutin à Cernay (Ermont). Le bref mais fructueux séjour de Jean-Jacques Rousseau (de 1757 à 1762) dans la Vallée consacrera la renommée de cette dernière. Le "pèlerinage" à Montmorency deviendra le point de passage obligé des excursions dominicales des Parisiens, à mesure que se développeront les "transports en commun" : les premières lignes de messageries par carrosses à quatre places et guinguettes à six ou huit places sont créées dans la Vallée en 1778.
Pendant cette période, cependant, la vie des paysans valmorencéens s’alourdit. Les parcelles de terre se réduisent de génération en génération et les familles, corvéables et taillables à merci, vivent modestement et sont dépendants des événements climatiques. C’est ainsi qu’ils sont frappés de plein fouet par la terrible grêle qui, le 13 juillet 1787, ravage toute l’Ile-de-France jusqu’à Orléans. Quarante-trois paroisses manquent leurs récoltes. L'hiver de 1788-1789 est marqué par un froid terrible. Les fontaines tarissent, les puits se changent en glaçons, les moulins à eau s'arrêtent, le vin gèle dans les caves. L’Oise est prise pendant six semaines à Pontoise. Quelques paysans essayent de manger du son, d'autres de l'herbe bouillie. Le froid cesse avec le printemps, mais la famine continue. Une grande disette frappe tout le royaume et, entre autres, la Vallée, dont le Plessis-Bouchard, Sannois, Taverny, Bessancourt…
A suivre :
4ème épisode : la Révolution puis l'emprise napoléonnienne sur la Vallée !
Déjà publiés :
1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge
2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Retourner à la page d'accueil Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"
Aucun commentaire
-
Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :
"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"


