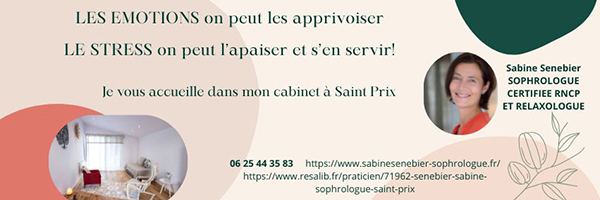aux newsletters du Journal ! Je m'inscris
Mercredi cinéma : "Au bout du conte" d'Agnès Jaoui avec Agathe Bonitzer, Arthur Dupont, Jean-Pierre Bacri…
Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :
Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont
Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône
Zoom nouveauté : "Au bout du conte" d'Agnès Jaoui
L'histoire
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il se mit à y croire.
Un film d'Agnès Jaoui avec Agathe Bonitzer, Arthur Dupont, Valérie Crouzet, Jean-Pierre Bacri, Dominique Valadié, Benjamin Biolay, Agnès Jaoui.
Bonus : propos d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri à propos de "Au bout du conte" (recueillis par Claire Vassé)
Quel est le point de départ d'"Au bout du conte" ?
Jean-Pierre Bacri : On est parti de la conclusion classique des contes : “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…” Vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants, ça nous paraissait aller un peu vite en besogne : il y a toute la vie à faire… Et dans la réalité, une fois que tu as rencontré ton prince ou ta princesse charmant(e), il se passe quoi ? Il se passe quoi une fois le livre refermé… ? On voulait une sorte de variation sur le couple tel qu’il est ou tel qu’il devient, et sur l’amour en général.Agnès Jaoui : Avec Jean-Pierre, on travaille toujours de la même façon, on prend un thème et on creuse : on a voulu réfléchir à la croyance, à partir du conte. On s’est amusé à traiter toutes les formes de foi et de croyances : la rumeur, les superstitions, ce qui reste des contes de fées dans la tête des gens, malgré eux. Il semble qu’on ne puisse pas faire autrement que de croire en quelque chose. On voulait parler de la nécessité ET de l’absurdité de la croyance. Et l’amour, au fond, c’est la crédulité la mieux partagée, c’est le conte de fées que chacun ou presque peut vivre au quotidien. Alors, on a imaginé des personnages qui avaient des référents empruntés au conte : on a ainsi écrit très vite l’histoire de Sandro et Laura avec cette idée que Cendrillon, cette fois-ci, était un homme.
Et puis les personnages se sont multipliés.
J.-P. B. : Sans systématiser : tel personnage appartient à un conte, tel autre pas. C’est plus composite, et plus aléatoire. Les personnages de conte nous intéressaient quand ils nous paraissaient exister dans la vraie vie : le roi ultra-possessif peut être un père capitaine d’industrie dont les soubresauts du capitalisme ébranleront le règne ; la sorcière, c’est une femme qui refuse sa vieillesse, etc.Mais vous, vous êtes crédules… ? Ou superstitieux ?
A. J. : Non, on est rationaliste, foncièrement, mais il m’arrive d’être superstitieuse tout en sachant que c’est complètement ridicule…
J.-P. B. : Archi rationaliste… Mais le doute, la superstition, ils se glissent partout. L’histoire de la voyante, je l’ai vécue, je peux la raconter tellement c’est ridicule. Quand j’avais 14 ou 15 ans, un type, pas une voyante, une espèce de crétin me propose de me faire mon thème astral. J’accepte. Il me dit : j’ai même la date de ta mort. Tout de suite, j’ai trouvé ça con, même à 15 ans, mais je m’en suis souvenu…
A. J. : Mais ne dis pas la date, s’il te plait, tu vas me refaire flipper.
Y a-t-il d’autres éléments personnels ?
A. J. : Bien sûr, on observe autour de nous, nos proches, nos amis...
J.-P. B. : Nos parents, nos sœurs, nos frères, nos voisins. C’est une discussion permanente entre nous, ça nous passionne. Tu sais ce qu’untel dit, etc.
Des petites histoires qui sont presque des films. Se reconnaissent-ils ?
A.J et J.-P. B. : Jamais.
A. J. : J’ai tout de même préféré prévenir l’amie qui avait en partie inspiré mon personnage. Quant à la scène où Jean-Pierre ne veut pas dire bonsoir aux enfants, on l’a vécue.
J.-P. B. : Oui, je trouvais ça artificiel ce clicheton qui dit qu’il faut aller dire bonsoir aux enfants parce qu’on l’a vu dans des feuilletons débiles. Cette espèce de rituel arbitraire. J’ai un rejet de certains rituels, je ne sais pas pourquoi. Quand mon personnage dit : “Y a pas de ciel du tout”, je trouve ça bien comme principe d’éducation. Je suis pour un peu d’athéisme.
A. J. : On ne peut pas dire aux enfants que la vie est injuste et que si ça se trouve, leur père va mourir demain. Enfin si, on peut, mais ça pose la question de ce qu’on veut leur transmettre. Je pense qu’on peut dire la vérité tout en rassurant un peu. Et ce n’est pas seulement vrai pour les enfants, les adultes aussi ont besoin d’être rassurés… Il n’y a qu’à voir le succès des films hollywoodiens et du happy end.
C’est la première fois que vous mettez en scène des enfants…
A. J. : Tant qu’on voyait ça de loin, on n’arrivait pas à écrire sur les enfants, on ne se sentait pas assez concernés, ni aptes. Mais on a vieilli, eu ou côtoyé des enfants, il fallait donc qu’il y en ait dans nos films, cela nous paraissait logique. On voulait aussi aborder la défaillance des parents, notamment à travers le personnage de Pierre.
Peut-on dire que le monde d’aujourd’hui, où les inégalités se creusent énormément, appelle le conte, comme un mensonge apaisant ?
A. J. : Oui, on peut le dire. Les publicités à la télévision, les émissions ou les journaux people ce sont des contes. On essaye de nous faire croire que la vie des riches est un conte de fées. Et il y a aussi le loto, où l’on peut gagner des millions d’un coup, et ces émissions où l’on refait en un coup de baguette magique le look ou l’appartement des gens et où l’on rend riche et célèbre un inconnu. Par ailleurs, les contes traduisent la peur des adultes et nous vivons une époque particulièrement anxiogène et culpabilisante, la crise et la fin du monde sont omniprésents. A chaque fois que tu allumes la TV ou la radio, tu entends que la Bourse va s’écrouler, que la planète va exploser, et que c’est de ta faute en plus… Du coup, on croit à tout et n’importe quoi. On est bien obligé de se raccrocher à quelque chose quand on pense qu’on va mourir dans la seconde suivante.
Le prince charmant, c’est un autre mythe qui perdure ?
A. J. : Oui, les schémas véhiculés par les contes marquent aussi très profondément les relations amoureuses. Moi, par exemple, j’ai attendu mon prince inconsciemment mais très profondément. Dans ce film j’avais envie de dire aux jeunes filles, en fait de dire à la jeune fille que j’étais : « N’attendez pas votre prince charmant, il y a d’autres modèles, d’autres façons d’être heureuse. » Tout ce qu’on nous assène sur la nécessité de la fidélité, le divorce comme un échec, est faux. Il n’y a pas une façon unique de s’aimer, il y en a des milliers.
J.-P. B. : Le valeureux chevalier, ce n’est pas mieux. Chacun son fardeau.
A. J. : Mais en général, le mec, il n’est pas là, il fume des clopes avec ses copains. Certes, il s’ennuie un peu mais il est libre, il bouge, il voyage… Alors que la princesse, elle est passive. C’est lui qui a le pouvoir, et qui arrive à la fin sur son beau cheval blanc pour embrasser la fille.
J.-P. B. : C’est vrai, c’est comme Pénélope qui attend et Ulysse...
A. J. : Est-ce vraiment le rêve de toutes les filles de trouver leur prince charmant et d’avoir des enfants ou est-ce un rêve inculqué par des milliers d’années d’éducation ? Ce n’est pas facile de se débarrasser de ces faux rêves, d’autant qu’ils sont insidieux, comme à chaque fois qu’il y a de l’inconscient collectif en jeu.
Comment s’est élaboré le scénario ?
A. J. : L’une des inspirations d’"Au bout du conte" est "Into the woods" de Stephen Sondheim – un compositeur dont Resnais est fan et qu’il m’avait fait découvrir. C’est une comédie musicale merveilleuse, où plusieurs personnages de contes se croisent dans un bois.
J.-P. B. : L’apport de chacun d’entre nous est plus indémêlable qu’avant. Au début de notre travail, Agnès s’intéressait davantage à la structure et moi aux dialogues…
A. J. : Jean-Pierre est toujours particulièrement brillant quant aux dialogues.
Agnès, sentez-vous une évolution dans votre rapport à la mise en scène ?
A. J. : Oui, de la préparation du film au mixage, j’ai ressenti une créativité et une liberté comme jamais auparavant. Depuis que je fais de la mise en scène, je vois qu’on peut dire beaucoup de choses sans paroles. Je me suis ainsi amusée avec des séquences qui reposent principalement sur la musique, comme, par exemple, la rencontre entre Sandro et Laura. La musique a pris une place que, jusque-là, seuls les mots tenaient. Le thème même du film demandait d’inventer une forme et ça a été un vrai travail d’équipe. Chaque jour, François Emmanuelli, le chef déco, Mathieu Vaillant, le premier assistant, Nathalie Raoul, la chef costumière et Lubomir Bakchev le chef opérateur, etc, arrivaient avec une idée nouvelle et on en discutait tous ensemble. Chacun essayait de comprendre ce que j’avais dans la tête (même moi, parfois), et on construisait ensemble le film.
(extrait dossier de presse – propos recueillis par Claire Vassé)
Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :
Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont
Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône
Zoom nouveauté : "Au bout du conte" d'Agnès Jaoui
L'histoire
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il se mit à y croire.
Un film d'Agnès Jaoui avec Agathe Bonitzer, Arthur Dupont, Valérie Crouzet, Jean-Pierre Bacri, Dominique Valadié, Benjamin Biolay, Agnès Jaoui.
Bonus : propos d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri à propos de "Au bout du conte" (recueillis par Claire Vassé)
Quel est le point de départ d'"Au bout du conte" ?
Jean-Pierre Bacri : On est parti de la conclusion classique des contes : “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…” Vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants, ça nous paraissait aller un peu vite en besogne : il y a toute la vie à faire… Et dans la réalité, une fois que tu as rencontré ton prince ou ta princesse charmant(e), il se passe quoi ? Il se passe quoi une fois le livre refermé… ? On voulait une sorte de variation sur le couple tel qu’il est ou tel qu’il devient, et sur l’amour en général.Agnès Jaoui : Avec Jean-Pierre, on travaille toujours de la même façon, on prend un thème et on creuse : on a voulu réfléchir à la croyance, à partir du conte. On s’est amusé à traiter toutes les formes de foi et de croyances : la rumeur, les superstitions, ce qui reste des contes de fées dans la tête des gens, malgré eux. Il semble qu’on ne puisse pas faire autrement que de croire en quelque chose. On voulait parler de la nécessité ET de l’absurdité de la croyance. Et l’amour, au fond, c’est la crédulité la mieux partagée, c’est le conte de fées que chacun ou presque peut vivre au quotidien. Alors, on a imaginé des personnages qui avaient des référents empruntés au conte : on a ainsi écrit très vite l’histoire de Sandro et Laura avec cette idée que Cendrillon, cette fois-ci, était un homme.
Et puis les personnages se sont multipliés.
J.-P. B. : Sans systématiser : tel personnage appartient à un conte, tel autre pas. C’est plus composite, et plus aléatoire. Les personnages de conte nous intéressaient quand ils nous paraissaient exister dans la vraie vie : le roi ultra-possessif peut être un père capitaine d’industrie dont les soubresauts du capitalisme ébranleront le règne ; la sorcière, c’est une femme qui refuse sa vieillesse, etc.Mais vous, vous êtes crédules… ? Ou superstitieux ?
A. J. : Non, on est rationaliste, foncièrement, mais il m’arrive d’être superstitieuse tout en sachant que c’est complètement ridicule…
J.-P. B. : Archi rationaliste… Mais le doute, la superstition, ils se glissent partout. L’histoire de la voyante, je l’ai vécue, je peux la raconter tellement c’est ridicule. Quand j’avais 14 ou 15 ans, un type, pas une voyante, une espèce de crétin me propose de me faire mon thème astral. J’accepte. Il me dit : j’ai même la date de ta mort. Tout de suite, j’ai trouvé ça con, même à 15 ans, mais je m’en suis souvenu…
A. J. : Mais ne dis pas la date, s’il te plait, tu vas me refaire flipper.
Y a-t-il d’autres éléments personnels ?
A. J. : Bien sûr, on observe autour de nous, nos proches, nos amis...
J.-P. B. : Nos parents, nos sœurs, nos frères, nos voisins. C’est une discussion permanente entre nous, ça nous passionne. Tu sais ce qu’untel dit, etc.
Des petites histoires qui sont presque des films. Se reconnaissent-ils ?
A.J et J.-P. B. : Jamais.
A. J. : J’ai tout de même préféré prévenir l’amie qui avait en partie inspiré mon personnage. Quant à la scène où Jean-Pierre ne veut pas dire bonsoir aux enfants, on l’a vécue.
J.-P. B. : Oui, je trouvais ça artificiel ce clicheton qui dit qu’il faut aller dire bonsoir aux enfants parce qu’on l’a vu dans des feuilletons débiles. Cette espèce de rituel arbitraire. J’ai un rejet de certains rituels, je ne sais pas pourquoi. Quand mon personnage dit : “Y a pas de ciel du tout”, je trouve ça bien comme principe d’éducation. Je suis pour un peu d’athéisme.
A. J. : On ne peut pas dire aux enfants que la vie est injuste et que si ça se trouve, leur père va mourir demain. Enfin si, on peut, mais ça pose la question de ce qu’on veut leur transmettre. Je pense qu’on peut dire la vérité tout en rassurant un peu. Et ce n’est pas seulement vrai pour les enfants, les adultes aussi ont besoin d’être rassurés… Il n’y a qu’à voir le succès des films hollywoodiens et du happy end.
C’est la première fois que vous mettez en scène des enfants…
A. J. : Tant qu’on voyait ça de loin, on n’arrivait pas à écrire sur les enfants, on ne se sentait pas assez concernés, ni aptes. Mais on a vieilli, eu ou côtoyé des enfants, il fallait donc qu’il y en ait dans nos films, cela nous paraissait logique. On voulait aussi aborder la défaillance des parents, notamment à travers le personnage de Pierre.
Peut-on dire que le monde d’aujourd’hui, où les inégalités se creusent énormément, appelle le conte, comme un mensonge apaisant ?
A. J. : Oui, on peut le dire. Les publicités à la télévision, les émissions ou les journaux people ce sont des contes. On essaye de nous faire croire que la vie des riches est un conte de fées. Et il y a aussi le loto, où l’on peut gagner des millions d’un coup, et ces émissions où l’on refait en un coup de baguette magique le look ou l’appartement des gens et où l’on rend riche et célèbre un inconnu. Par ailleurs, les contes traduisent la peur des adultes et nous vivons une époque particulièrement anxiogène et culpabilisante, la crise et la fin du monde sont omniprésents. A chaque fois que tu allumes la TV ou la radio, tu entends que la Bourse va s’écrouler, que la planète va exploser, et que c’est de ta faute en plus… Du coup, on croit à tout et n’importe quoi. On est bien obligé de se raccrocher à quelque chose quand on pense qu’on va mourir dans la seconde suivante.
Le prince charmant, c’est un autre mythe qui perdure ?
A. J. : Oui, les schémas véhiculés par les contes marquent aussi très profondément les relations amoureuses. Moi, par exemple, j’ai attendu mon prince inconsciemment mais très profondément. Dans ce film j’avais envie de dire aux jeunes filles, en fait de dire à la jeune fille que j’étais : « N’attendez pas votre prince charmant, il y a d’autres modèles, d’autres façons d’être heureuse. » Tout ce qu’on nous assène sur la nécessité de la fidélité, le divorce comme un échec, est faux. Il n’y a pas une façon unique de s’aimer, il y en a des milliers.
J.-P. B. : Le valeureux chevalier, ce n’est pas mieux. Chacun son fardeau.
A. J. : Mais en général, le mec, il n’est pas là, il fume des clopes avec ses copains. Certes, il s’ennuie un peu mais il est libre, il bouge, il voyage… Alors que la princesse, elle est passive. C’est lui qui a le pouvoir, et qui arrive à la fin sur son beau cheval blanc pour embrasser la fille.
J.-P. B. : C’est vrai, c’est comme Pénélope qui attend et Ulysse...
A. J. : Est-ce vraiment le rêve de toutes les filles de trouver leur prince charmant et d’avoir des enfants ou est-ce un rêve inculqué par des milliers d’années d’éducation ? Ce n’est pas facile de se débarrasser de ces faux rêves, d’autant qu’ils sont insidieux, comme à chaque fois qu’il y a de l’inconscient collectif en jeu.
Comment s’est élaboré le scénario ?
A. J. : L’une des inspirations d’"Au bout du conte" est "Into the woods" de Stephen Sondheim – un compositeur dont Resnais est fan et qu’il m’avait fait découvrir. C’est une comédie musicale merveilleuse, où plusieurs personnages de contes se croisent dans un bois.
J.-P. B. : L’apport de chacun d’entre nous est plus indémêlable qu’avant. Au début de notre travail, Agnès s’intéressait davantage à la structure et moi aux dialogues…
A. J. : Jean-Pierre est toujours particulièrement brillant quant aux dialogues.
Agnès, sentez-vous une évolution dans votre rapport à la mise en scène ?
A. J. : Oui, de la préparation du film au mixage, j’ai ressenti une créativité et une liberté comme jamais auparavant. Depuis que je fais de la mise en scène, je vois qu’on peut dire beaucoup de choses sans paroles. Je me suis ainsi amusée avec des séquences qui reposent principalement sur la musique, comme, par exemple, la rencontre entre Sandro et Laura. La musique a pris une place que, jusque-là, seuls les mots tenaient. Le thème même du film demandait d’inventer une forme et ça a été un vrai travail d’équipe. Chaque jour, François Emmanuelli, le chef déco, Mathieu Vaillant, le premier assistant, Nathalie Raoul, la chef costumière et Lubomir Bakchev le chef opérateur, etc, arrivaient avec une idée nouvelle et on en discutait tous ensemble. Chacun essayait de comprendre ce que j’avais dans la tête (même moi, parfois), et on construisait ensemble le film.
(extrait dossier de presse – propos recueillis par Claire Vassé)
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Aucun commentaire
-
Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :
"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"