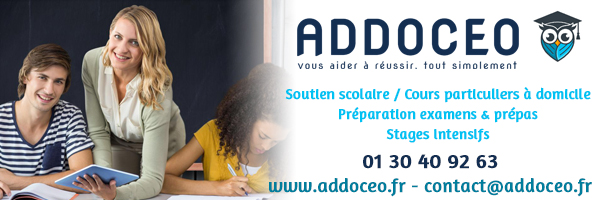aux newsletters du Journal ! Je m'inscris
Juin 40 : Hélène Masdier, habitante d’Ermont, nous livre quelques souvenirs.
Hélène Masdier, née Fourquemin, voit le jour en 1924 à Pontoise. Aujourd’hui elle vit à Ermont. Elle aime se plonger dans l’Histoire. L’année dernière, elle m’a livré quelques souvenirs : son arrivée à Franconville, sa vie pendant l’exode de juin 40, puis pendant l’occupation… . Passionnant !
« Je viens vous raconter un petit coin de ma vie. Fille et petite fille unique, j’ai eu une enfance dorée. Mes parents étaient tous les deux établis à leur compte : mon père, «électricien en chambre», dans le quartier du Marais à Paris, ma mère polisseuse en bijoux, dans le Sentier. Tous les ans, nous partions quinze jours en vacances dans différents coins de France. Mes grands-parents m’emmenaient également quinze jours au Havre dans la famille de mon deuxième grand-père, le seul que j’ai connu.
Jeunesse dorée jusqu’au décès de ma grand-mère, la veille de mes 13 ans, en 1937. Mes parents sont alors expropriés de notre appartement du Marais pour installer partout les sanitaires. Seuls sont restés dans l’immeuble la sœur et le beau-frère de l’écrivain Georges Bernanos qui, eux, avaient tout le confort ! Quand mes parents ont été prévenus, ils ont cherché à acheter une maison. Ma mère a choisi celle qui était la plus isolée et en plus mauvais état ! C’était son choix et mon père n’a eu qu’à s’incliner. Mais il leur a fallu emprunter pour les travaux à un pharmacien de Franconville. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué : ce pharmacien n’acceptait pas les remboursements dans son officine. Il fallait aller régler à la recette des impôts de Taverny. Nous habitions à Franconville sur le trajet de la future A115 (ma mère a connu plus tard une nouvelle expropriation…). Alors chaque trimestre, je partais à vélo, l’argent liquide dans mon petit sac à main bordeaux accroché au guidon, à travers champs jusqu’à la gare de Vaucelles, puis sur la nationale jusqu’au bâtiment des impôts. Seuls un ou deux cultivateurs m’apercevaient et je continuais mon bonhomme de chemin. Qu’aurait-il pu m’arriver dans la plaine ? Je ne risquais rien.
J’étais seule à la maison quand il n’y avait pas d’école et je peux vous dire que j’ai connu toutes les rues de Franconville, Plessis Bouchard, Ermont et Sannois et jusqu’à la route stratégique à Cormeilles.
Puis est arrivée la guerre et les restrictions. Le soir, en sortant de l’école, j’allais faire la queue dans une ferme en haut de la côte Saint-Marc à Franconville, pour obtenir un litre de lait sans ticket. J’allumais la cuisinière et faisais cuire la soupe tout en faisant mes devoirs. Un soir, je ne me suis même pas aperçue qu’il y avait un feu de cheminée, j’étais plongée dans les maths et plus rien ne comptait. Quand j’ai senti le chaud, les tuyaux étaient rouges, j’ai couru chez les voisins qui m’ont assuré que le feu était presque éteint… cela ne les avait pas inquiétés…
Tous les mois, j’allais toujours sur mon vélo, jusqu’au bas d’Herblay, chez des commerçants du marché d’Ermont qui me vendaient 5 kg de pommes de terre sans ticket et, pour faire le pendant sur mon guidon, 5 kg de carottes. De temps en temps, je prenais la brouette et allais jusqu’à Saint-Gratien (rassurez-vous, en bordure d’Ermont) chez un charbonnier qui me vendait un sac de 50 kg de charbon, toujours sans ticket. Puis quand j’ai quitté l’école, après le brevet et ne travaillant pas encore, j’ai trouvé tout naturel de fendre et de scier des arbres que mon père avait réussi à acheter.
Après la Libération, mon mari trouvait, de temps en temps, un sac de poussier à rapporter de chez le charbonnier de la chaussée Jules César. Je faisais tremper des journaux et remplissait des feuilles d’une poignée de poussier. J’essorais le mieux possible. Une fois séchés, ces sortes de boulets « tenaient » le feu plusieurs heures.
J’ai oublié de vous dire que, pendant l’exode en juin 1940, j’allais tous les matins chez un charcutier de la place de la République à Franconville. Une équipe de jeunes partait cueillir des petits pois, des carottes, des navets, des salades dans les champs dont les cultivateurs avaient fui en province et un autre groupe auquel j’appartenais épluchait le tout. Le charcutier effectuait la cuisson et nous repartions, chacun, avec une gamelle pleine de macédoine. Que c’était bon et ça nous changeait des topinambours et des rutabagas.
Beaucoup d’enfants ont du faire pire que moi, mais parmi mes anciennes camarades d’école, je suis la seule à avoir autant aidé mes parents. Je ne peux même pas raconter cela à mes petits-enfants, pourtant adultes, ça ne les intéresse pas, c’est de l’histoire ancienne.
Moi je trouvais cela très naturel d’aider mes parents. Et ce n’est rien par rapport à ce qu’a fait mon mari. A 11 ans et demi, étant le plus jeune d’une fratrie de dix, le seul à ne pas travailler, donc à ne pas rapporter de paie, c’est lui qui s’est occupé de sa mère paralysée jusqu’au décès de celle-ci deux ans plus tard. »
Hélène Masdier
Hélène Masdier, née Fourquemin, voit le jour en 1924 à Pontoise. Aujourd’hui elle vit à Ermont. Elle aime se plonger dans l’Histoire. L’année dernière, elle m’a livré quelques souvenirs : son arrivée à Franconville, sa vie pendant l’exode de juin 40, puis pendant l’occupation… . Passionnant !
« Je viens vous raconter un petit coin de ma vie. Fille et petite fille unique, j’ai eu une enfance dorée. Mes parents étaient tous les deux établis à leur compte : mon père, «électricien en chambre», dans le quartier du Marais à Paris, ma mère polisseuse en bijoux, dans le Sentier. Tous les ans, nous partions quinze jours en vacances dans différents coins de France. Mes grands-parents m’emmenaient également quinze jours au Havre dans la famille de mon deuxième grand-père, le seul que j’ai connu.
Jeunesse dorée jusqu’au décès de ma grand-mère, la veille de mes 13 ans, en 1937. Mes parents sont alors expropriés de notre appartement du Marais pour installer partout les sanitaires. Seuls sont restés dans l’immeuble la sœur et le beau-frère de l’écrivain Georges Bernanos qui, eux, avaient tout le confort ! Quand mes parents ont été prévenus, ils ont cherché à acheter une maison. Ma mère a choisi celle qui était la plus isolée et en plus mauvais état ! C’était son choix et mon père n’a eu qu’à s’incliner. Mais il leur a fallu emprunter pour les travaux à un pharmacien de Franconville. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué : ce pharmacien n’acceptait pas les remboursements dans son officine. Il fallait aller régler à la recette des impôts de Taverny. Nous habitions à Franconville sur le trajet de la future A115 (ma mère a connu plus tard une nouvelle expropriation…). Alors chaque trimestre, je partais à vélo, l’argent liquide dans mon petit sac à main bordeaux accroché au guidon, à travers champs jusqu’à la gare de Vaucelles, puis sur la nationale jusqu’au bâtiment des impôts. Seuls un ou deux cultivateurs m’apercevaient et je continuais mon bonhomme de chemin. Qu’aurait-il pu m’arriver dans la plaine ? Je ne risquais rien.
J’étais seule à la maison quand il n’y avait pas d’école et je peux vous dire que j’ai connu toutes les rues de Franconville, Plessis Bouchard, Ermont et Sannois et jusqu’à la route stratégique à Cormeilles.
Puis est arrivée la guerre et les restrictions. Le soir, en sortant de l’école, j’allais faire la queue dans une ferme en haut de la côte Saint-Marc à Franconville, pour obtenir un litre de lait sans ticket. J’allumais la cuisinière et faisais cuire la soupe tout en faisant mes devoirs. Un soir, je ne me suis même pas aperçue qu’il y avait un feu de cheminée, j’étais plongée dans les maths et plus rien ne comptait. Quand j’ai senti le chaud, les tuyaux étaient rouges, j’ai couru chez les voisins qui m’ont assuré que le feu était presque éteint… cela ne les avait pas inquiétés…
Tous les mois, j’allais toujours sur mon vélo, jusqu’au bas d’Herblay, chez des commerçants du marché d’Ermont qui me vendaient 5 kg de pommes de terre sans ticket et, pour faire le pendant sur mon guidon, 5 kg de carottes. De temps en temps, je prenais la brouette et allais jusqu’à Saint-Gratien (rassurez-vous, en bordure d’Ermont) chez un charbonnier qui me vendait un sac de 50 kg de charbon, toujours sans ticket. Puis quand j’ai quitté l’école, après le brevet et ne travaillant pas encore, j’ai trouvé tout naturel de fendre et de scier des arbres que mon père avait réussi à acheter.
Après la Libération, mon mari trouvait, de temps en temps, un sac de poussier à rapporter de chez le charbonnier de la chaussée Jules César. Je faisais tremper des journaux et remplissait des feuilles d’une poignée de poussier. J’essorais le mieux possible. Une fois séchés, ces sortes de boulets « tenaient » le feu plusieurs heures.
J’ai oublié de vous dire que, pendant l’exode en juin 1940, j’allais tous les matins chez un charcutier de la place de la République à Franconville. Une équipe de jeunes partait cueillir des petits pois, des carottes, des navets, des salades dans les champs dont les cultivateurs avaient fui en province et un autre groupe auquel j’appartenais épluchait le tout. Le charcutier effectuait la cuisson et nous repartions, chacun, avec une gamelle pleine de macédoine. Que c’était bon et ça nous changeait des topinambours et des rutabagas.
Beaucoup d’enfants ont du faire pire que moi, mais parmi mes anciennes camarades d’école, je suis la seule à avoir autant aidé mes parents. Je ne peux même pas raconter cela à mes petits-enfants, pourtant adultes, ça ne les intéresse pas, c’est de l’histoire ancienne.
Moi je trouvais cela très naturel d’aider mes parents. Et ce n’est rien par rapport à ce qu’a fait mon mari. A 11 ans et demi, étant le plus jeune d’une fratrie de dix, le seul à ne pas travailler, donc à ne pas rapporter de paie, c’est lui qui s’est occupé de sa mère paralysée jusqu’au décès de celle-ci deux ans plus tard. »
Hélène Masdier
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Rencontres de François"
Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.
Retourner à la page d'accueil Retourner à la page "Rencontres de François"
Aucun commentaire
-
Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :
"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"